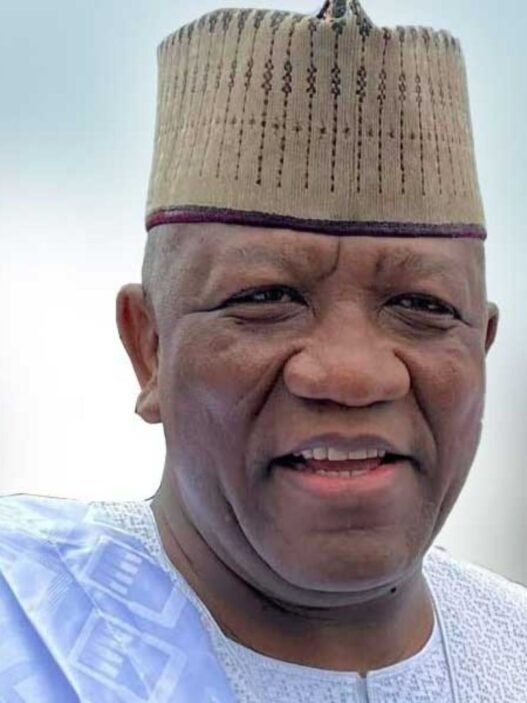Par-delà les discours de tribune et les communiqués ministériels bien ficelés, une question demeure lancinante. Les politiques publiques africaines soutiennent-elles réellement l’entrepreneuriat ou se contentent-elles d’en épouser les apparences ? Car aujourd’hui, dans presque toutes les capitales africaines, l’entrepreneuriat est érigé en solution miracle face au chômage des jeunes, à la précarité et à la croissance inclusive. Mais derrière l’euphorie des mots, les réalités du terrain peignent un tout autre tableau.
Il ne se passe quasiment plus une année sans qu’un gouvernement n’annonce un nouveau programme dédié à l’entrepreneuriat. Fonds de garantie, plateformes numériques de formalisation, exonérations fiscales pour les jeunes entreprises, créations d’incubateurs publics, campagnes de sensibilisation à l’esprit d’entreprise. Sur le papier, les initiatives se multiplient et paraissent prometteuses.
Au Sénégal, la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide (DER) est régulièrement citée comme modèle. En Côte d’Ivoire, le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ-Gouv) s’est doté de multiples volets pour « accompagner les jeunes porteurs de projet ». Au Togo, le Fonds d’Appui aux Initiatives Économiques des Jeunes (FAIEJ) tente d’identifier, de former et de financer les jeunes entrepreneurs. Le Bénin a mis en place une Agence de Développement de l’Entrepreneuriat des Jeunes (ADEJ), pendant que le Rwanda ou le Ghana vantent leurs programmes de financement à guichet unique.
Mais qu’en est-il de l’application ? Ces dispositifs souffrent, pour la plupart des cas, de maux structurels, notamment de lourdeurs administratives, critères d’éligibilité peu clairs, manque de transparence dans l’attribution des financements, absence de suivi post-lancement. Pour beaucoup d’entrepreneurs, ces politiques ressemblent davantage à un parcours du combattant qu’à un tremplin vers la réussite.
Programme dédié à l’entrepreneuriat : l’accès, le grand malentendu

La majorité des jeunes porteurs de projet n’ont pas accès à ces politiques publiques. Soit parce qu’ils ignorent leur existence, soit parce qu’ils ne savent pas comment y accéder, ou encore parce que les procédures sont dissuasives. Les outils digitaux mis en place par certaines administrations restent peu utilisés, soit faute de connectivité adéquate dans les zones rurales, soit parce que les plateformes sont mal conçues ou trop complexes.
À cela s’ajoute la confiance. Beaucoup de jeunes entrepreneurs ne croient pas à l’impartialité des systèmes d’attribution. Ils dénoncent le favoritisme, le clientélisme et la politisation des programmes. Dès lors, certains renoncent à postuler ou se tournent vers des solutions informelles ou communautaires, bien que plus limitées.
Les politiques publiques en faveur de l’entrepreneuriat donnent parfois l’impression de chercher davantage des résultats médiatiques que des impacts durables. Les forums, les salons de l’entrepreneuriat, les concours de pitch, les remises de chèques en grande pompe, etc. Tout cela alimente une communication institutionnelle forte, mais peu corrélée à une transformation de fond de l’écosystème entrepreneurial.
Or, créer une entreprise en Afrique reste une aventure périlleuse. Outre le manque de financement, les entrepreneurs doivent affronter des problèmes d’infrastructure, des délais administratifs déraisonnables, des taxes inadaptées à leurs modèles et l’absence d’un véritable accompagnement technique. Le cadre d’appui institutionnel n’est que rarement à la hauteur des enjeux.
Face à ce décalage, il est urgent de changer de paradigme avec quelques pistes concrètes qui méritent également d’être explorées. Il faut rendre les dispositifs qui existent plus simples, plus accessibles, plus équitables et proposer des mécanismes de financement adaptés à la réalité des jeunes entreprises. Il devient aussi urgent de renforcée la transparence dans l’attribution des aides publiques, avec des critères clairs, des plateformes ouvertes et un véritable suivi pour éviter les dérives et restaurer la confiance.
L’Afrique a besoin d’entrepreneurs pour relever ses défis. Mais les entrepreneurs africains ont besoin d’un État qui écoute avant de décider, qui accompagne plutôt que de contrôler, qui simplifie au lieu de complexifier. Les politiques publiques ne doivent plus être des vitrines politiques, mais des leviers concrets d’émancipation économique.
Reconnaître ce décalage entre le discours et la réalité est un premier pas. Le suivant consiste à agir, avec méthode et écoute. Car la vitalité entrepreneuriale ne se décrète pas. Elle se construit.