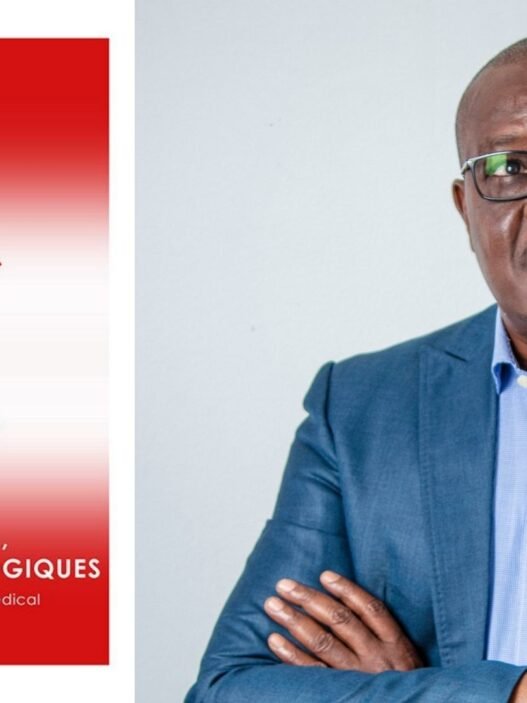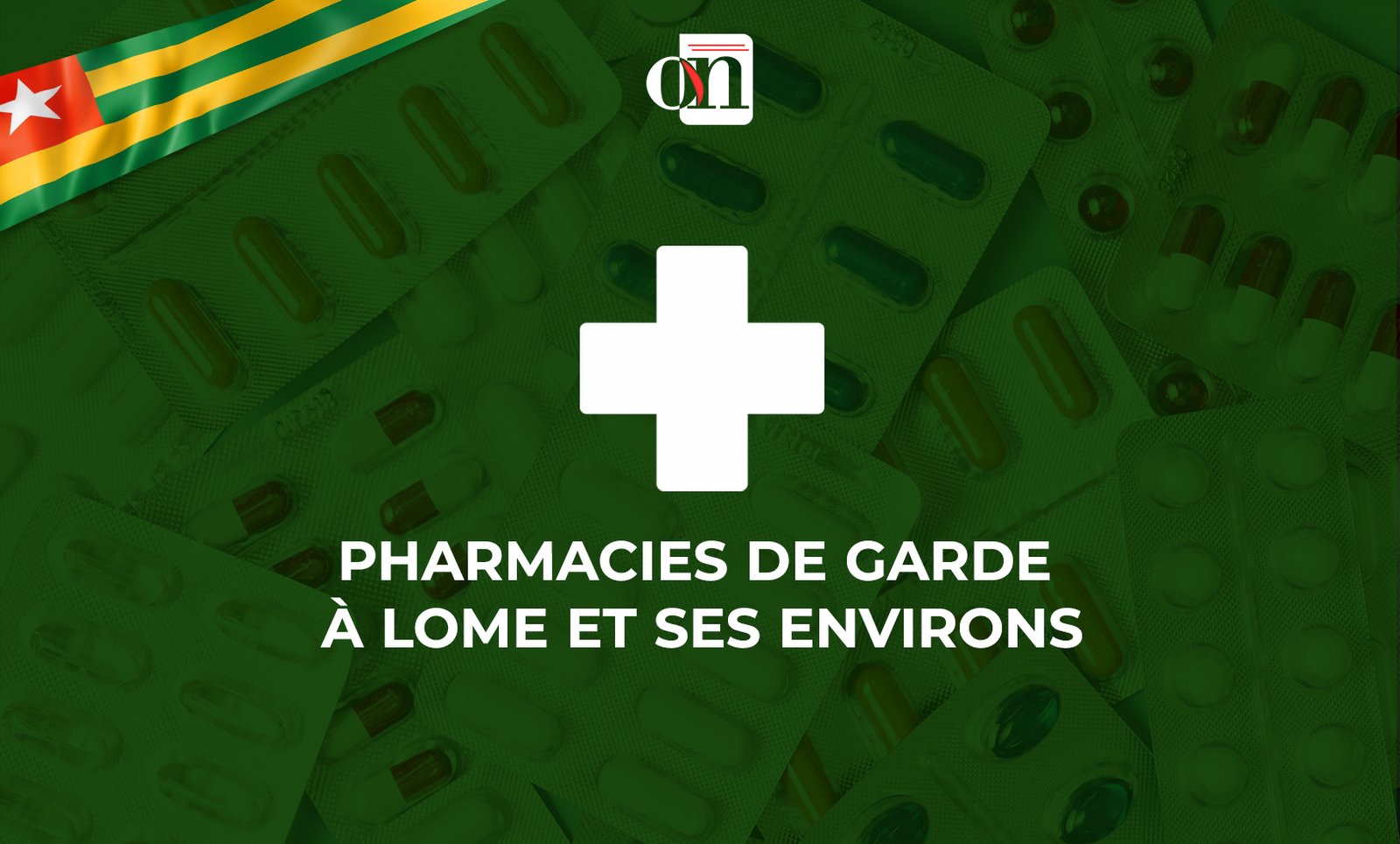Ngugi wa Thiong’o, écrivain kényan reconnu dans le monde pour son engagement contre la colonisation et pour la défense des langues africaines, est décédé le mercredi 28 mai 2025 à l’âge de 87 ans.
Écrivain de la décolonisation des langues, Ngugi wa Thiong’o n’est plus de ce monde. L’annonce a été faite par sa fille, Wanjiku Wa Ngugi : « C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père. Il a vécu une vie bien remplie et a mené le bon combat».
Romancier, dramaturge, essayiste et professeur d’université, Ngugi wa Thiong’o était l’une des grandes voix de la littérature africaine moderne. Il a marqué plusieurs générations par ses œuvres engagées et ses prises de position en faveur de la liberté culturelle en Afrique.
Né en 1938 à Kamiriithu, un village proche de Nairobi au Kenya, l’écrivain a grandi à une époque où le pays était encore sous domination britannique. Très tôt, il a commencé à écrire sur les injustices vécues par les siens. En 1964, il publie Weep Not, Child, son tout premier roman écrit en anglais, qui parle de la souffrance du peuple kényan pendant la colonisation.
Mais cet auteur ne voulait pas seulement raconter des histoires. Il voulait éveiller les consciences et redonner de la fierté aux peuples africains. Son objectif : faire entendre la voix de l’Afrique, dans ses propres langues.
En 1977, Ngugi écrit avec un autre auteur une pièce de théâtre intitulée Ngaahika Ndeenda (« Je me marierai quand je le voudrai »), jouée dans sa langue maternelle, le kikuyu. La pièce critique les injustices sociales et politiques dans le Kenya de l’après-indépendance. Cet ouvrage engendra une arrestation.
Pendant son emprisonnement, Ngugi wa Thiong’o décide de ne plus jamais écrire en anglais, la langue de l’ancien colonisateur. Il rédige alors son premier roman en kikuyu, Caitaani Mutharaba-ini (« Le Diable sur la Croix »)… sur du papier toilette, faute d’autre support.
Ce geste fort est expliqué dans son essai Décoloniser l’esprit (1986), devenu un ouvrage de référence pour tous ceux qui s’intéressent à la décolonisation culturelle. Il y affirme que chaque langue est porteuse d’un regard sur le monde, et que les langues africaines doivent être respectées au même titre que le français ou l’anglais.
Grâce au soutien de nombreuses personnes à travers le monde, Ngugi wa Thiong’o est libéré. Il part vivre en Europe, puis aux États-Unis, où il enseigne dans de grandes universités comme Yale, New York University et l’Université de Californie à Irvine.
Même en exil, il reste fidèle à ses valeurs. Il continue d’écrire, de publier, de parler dans des conférences. Il revient au Kenya en 2004, mais est violemment agressé lors de ce voyage. Cela ne l’empêche pas de continuer son combat, notamment avec son livre Pour une Afrique libre, publié en 2017.
Ngugi wa Thiong’o a souvent été pressenti pour le prix Nobel de littérature, mais ne l’a jamais obtenu. Une absence remarquée, mais qu’il relativise lui-même : « Être distingué par le Nobel est valorisant, mais ce n’est pas essentiel », disait-il.
Pour lui, le plus important était de contribuer à libérer les esprits africains, en valorisant leurs langues, leurs histoires et leurs cultures.
Ngugi wa Thiong’o n’est plus, mais son œuvre et son message restent vivants. En défendant le droit des Africains à penser et s’exprimer dans leurs propres langues, il a ouvert la voie à de nombreuses générations d’auteurs, d’intellectuels et de militants.
Son nom reste associé à un combat essentiel, celui de la fierté culturelle africaine. À travers ses livres, ses idées et ses engagements, Ngugi wa Thiong’o rappelle que les mots peuvent résister, et que la littérature peut libérer.